
|
Patrimoine Naturel
|
Fiche
technique de la rivière |
Longueur: 115 km
Source: Chaulieu. (Saint-Sauveur de Chaulieu/ Saint-Martin de Chaulieu/ Saint-Christophe de Chaulieu). La Vire est formée de deux cours d'eau prenant leur source aux limites des départements de Calvados, de L'Orne et de la Manche à la "Butte brimballe" qui est le culmen du département de la Manche.
Chute: 303
m. Pente faible due à de nombreux méandres. Altitude à Saint-Lô: 25m.
Vitesse moyenne du courant: 0,75m/s.
Débit: 45m3 (Seine : 520m3).
Largeur: Elle varie de 500m à Condé-sur-Vire à 100m à La Chapelle sur Vire.
La vallée est assez encaissée en amont: les versants ont une atltitude située
entre 200m à Pont farcy et 40m.
Affluents: La Joigne (rive gauche) et l'Elle (rive droite), et de nombreux petits affluents dont la Dollée et le Torteron à Saint-Lô
De
Pont-Farcy à la Meauffe, la Vire possède un relief original de vallée encaissée
à méandre et une gamme de paysages diversifiés agréables et préservés. Les différentes
essences dans le maillage bocager, les collines, la présence de versants boisés
donnent une grande variété aux paysages de la vallée, ainsi que les méandres
du cours d'eau, et son « balancement » d'un versant à líautre. En fond de vallée
et sur les versants en pente douce, les prairies dominent avec un paysage bocager.
Sur les pentes les plus raides, on a des petits bois de feuillus (une exception
: résineux au Mesnil-Raoult) et parfois quelques affleurements rocheux (Roches
du Ham).
En dehors de quelques bourgs et de l'agglomération de
Saint-Lô, les bords de Vire sont peu construits. Les versants n'ont pas fait
l'objet d'un « mitage » par des habitations dispersées, comme sur d'autres cours
d'eau. 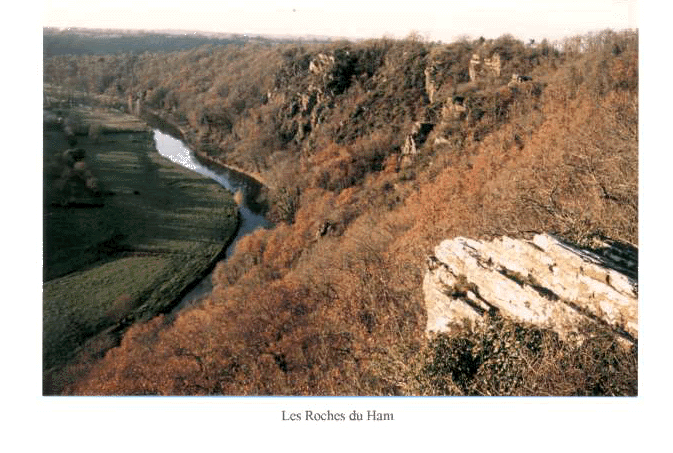
Plusieurs
points de vue sur la Vallée sont intéressants:
- Entre Pont-Farcy et Tessy le long de la D 374
- A Domjean, belle vue sur la Chapelle-sur-Vire depuis le chemin de croix
- Panorama des Roches du Ham
- A Saint-Romphaire, depuis la D53 vers le Hamel du Jardin
- A Saint-Lô, vue depuis la Tour Beaux-Regards (Promenade des remparts)
- A Agneaux, panorama depuis le bois de la Falaise
- Agneaux : vues depuis les abords du Hameau Le Tailleux.
- Rampan : vue depuis les abords de l'Hotel Perrat, vers la Maison Crosnier
- Hébécrevon : points de vue depuis les vallons de Rouloux-Godard et de Rajon.
(Source : Ghislaine Briault, D.D.E « Vallée de la Vire. Mise en valeur pour
le tourisme et les loisirs entre Pont-Farcy et Pont-Hébert »).
Mais
des points noirs dégradent la qualité des paysages de la vallée:
- Lignes à Haute-tension au niveau de l'écluse du Rocreuil
- Carrière de La Chapelle-sur-Vire et la route neuve
- Sites industriels désaffectés : abattoirs de Saint-Lô, usine Claudel à Pont-Hébert/La
Meauffe.
- Architecture des microcentrales (cubes de béton).
- Toits en tôle dans des hameaux du bord de Vire.
- Décharges

paysage
bocager
Paysage original, fruit de l'action de l'homme depuis des sciècles, le bocage se caractérise par son maillage plus ou moins dense de haies, souvent plantées sur des talus ou "fossés" délimitant prairies, champs cultivés ou vergés. L'aspect général du bosage varie suivant la forme et la taille des mailles, l'importance des talus et des chemins creux, la présence ou non d'arbres de haut jet et la nature des essences présentes.
| La qualité de l'eau |
Les
produits "verts" ne sont pas les plus propres!
(toutes les marques sont soumises à la même règlementation) Consultez la liste des produits qui ne contiennent pas de phosphates ni de phosphonates |
La pollution des milieux aquatiques affecte l’homme, de manière directe dans les sources d’eau de consommation, et indirecte lorsque la diminution des zones humides (et de leur biodiversité) et la réduction des haies entraînent inondations et sécheresse.
L’eau est au coeur de conflits car elle intéresse l’ensemble de la population : les individuels, les agriculteurs, les industriels, les pêcheurs, les usagers de loisirs... L’eau est un " patrimoine commun " qui doit être accessible à tous à un même prix mais la gestion de sa qualité a un coût. Les pressions qui interviennent sur la qualité de l’eau sont d’ordre domestique, industriel, et agricole.
Lorsque l’on considère un cours d’eau , on parle du bassin versant ou bassin hydrographique qui englobe tout le tracé du cours d’eau ainsi que celui de ses affluents primaires. Le bassin versant constitue donc l'ensemble de la zone susceptible d’être affectée en cas de pollution en un point. Ce sont toutes les gouttes de pluies qui tombent, s'écoulent, et se rejoignent en un même endroit pour former une rivière qui débouche sur un fleuve ou dans la mer. Les frontières naturelles en sont la crête des montagnes: les gouttes de pluie qui tombent sur un versant de la montagne vont alimenter une rivière, tandis que les gouttes de pluie qui tombent sur l'autre versant de la montagne vont alimenter une rivière voisine. Une administration propre a été créée (l’Agence de L’Eau), pour découper la France en 6 grands bassins, qui ne correspondent pas aux découpages administratifs.
La Vire dépend du bassin et de l’agence Seine-Normandie.
Le bassin versant de la Vire peut se diviser en 3 unités :
La géologie du bassin de la Vire ne permet pas de disposer de réserves d’eau souterraines importantes. Les eaux se retrouvent rapidement dans le réseau hydrographique et sont évacuées vers la mer. L’été, des périodes d’étiage se font sentir. Par ailleurs, les espaces de rétention d’eau sont mis à mal. En effet, les moyenne et basse vallées ont été modifiées au niveau du cours principal, nous pouvons notamment constater que les zones humides de fond de vallée sont très réduites. Enfin, sur l’ensemble du bassin versant la modernisation des pratiques agricoles (destruction des haies, sols nus, réserves d’eau non entretenues…) a accéléré le cycle de l’eau et donc raccourci la phase d’auto-épuration.
1- les pressions domestiques. Le traitement des stations d’épuration est satisfaisant pour les réducteurs d’oxygène mais, pour les composants propices à l’eutrophisation (azote et phosphore) le rendement des traitements est très faible. En période d’étiage en 1999, trois stations d’épuration ont eu un rejet trop important pour que la rivière ne puisse les assimiler : Saint-Lô, Vire et surtout Torigny.
Enfin, la majeur partie des résidus est épandue : les métaux lourd (plomb, mercure) retournent dans la nature. Notre région est la plus épargnée par ces pollutions dangereuses car ces métaux ne sont présents qu'en très faible quantité dans la nature.
Eutrophisation: déséquilibre écologique d 'une rivière, par enrichissement de l'eau en sels minéraux qui entra^ne la prolifération de la végétation aquatique qui va, la nuit, appauvrir le milieu en oxygène et asphyxier les poissons. Les algues vont ensuite se décomposer en libérant des gaz toxiques ammoniaque et SH2
Elle est causée par l'excès de phosphates et de nitrates. Les sédiments, restes de matières organiques, contenus dans les eaux usées, accentuent le phénomène d'eutrophisation. Les phosphates sont contenus dans les lessives. Ils sont interdits dans les lessives domestiques, mais pas encore pour l'usage industriel.
Une température élevée, un éclairement fort pour la photosynthèse, un courant faible, une faible amplitude de la ligne d'eau, sont les facteurs physiques qui favorisent l'eutrophisation.
2- les pressions industrielles sont représentées par le secteur agroalimentaire (boues résiduelles importantes). Les pollutions toxiques proviennent également des laboratoires de photographes, dentistes, radiologues, hôpitaux, imprimeries, réparation automobile, pressing et coiffeurs.
Une entreprise à Vire rejette directement des matières oxydables, et 12 autres entreprises sont raccordées aux stations d’épuration, mais les traitements sont quasi inefficaces.
Il y a trois sites pollués avec impact sur les eaux souterraines : La Graverie, Saint-Lô et La Meauffe.
3-
les pressions agricoles sont importantes sur notre territoire. 60% des
apports d’azote épandu proviennent des rejets des bovins, (c'est un des plus
forts taux au niveau national). Les changements des pratiques agricoles sont
également source de pollution:
* Parcelles plus grandes : disparition des haies et retenues d’eau
* Culture du mais en augmentation : intrants (surtout au printemps) et
ruissellements
* Utilisation de produits phytosanitaires en augmentation. La teneur en atrazine
en aval de Saint-Lo est plus de 10 fois supérieur à la norme Européenne
et 5 à 10 fois au niveau de Pont-Farcy.
La Vire traverse des couches de schiste briovériens qui sont rattachés au Massif Armoricain. Au niveau de la Meauffe et de Cavigny on rencontre des roches calcaires (d'où est extraite la chaux).
Le sous-sol manchois
est constitué de schistes fossilisés par des dépôts sédimentaires au long de
l'ère primaire (370 M années). Puis des plissements ont provoqué des reliefs
de St-Lô à Granville et de Flamanville à la pointe de Barfleur.
La partie centrale du département s'est affaissée pendant l'ère secondaire en
attirant de nombreux cours d'eau: La Douve, la Taute, la Vire, l'Aure et leurs
affluents: le Merderet, le Lozon, la terrette, l'Elle.. 
Formation des marécages: des débris végétaux accumulés dans l'eau
de pluie retenue par le sol pauvre imperméable ont créé de la mousse aquatique,
la sphaigne,comblant les cuvettes. Ainsi d'autres végétaux se sont installés
sur ces coussins formant les tourbières. Le"bas pays" était recouvert 8 à 9
mois par une nappe d'eau, la mer remontait à 10kms en amont de l'actuelle embouchure
de la Vire, à l'époque romaine. Au XIIe siècle on commença à édifier des digues
(ou dicks).
Saint-Lô et le bassin de la Vire
extrait d'une étude de Maurice LANTIER
Partagée du Nord au Sud par la vallée de la Vire, la petite région qui ferme le département à l'Est, gravite autour de Saint-Lô, devenue par la force de l'histoire, le chef-lieu de la Manche.
Elle regroupe l'essentiel des communes de l'arrondissement de Saint-Lô, à l'exception des cantons de Carentan, Villedieu et Percy.
De faibles dimensions, elle présente une suite de paysages variés, allant des hauteurs mamelonnées de Tessy-sur-Vire et de Saint-Jean-des-Baisants, jusqu'aux horizons marécageux de Saint-Fromond, Airel et Montmartin-en-Graignes. Tous sont drainés par la Vire et ses affluents. Seuls échappent, les secteurs de Marigny, La Chapelle-en-Juger et Saint-Gilles, dont les eaux filent vers le Lozon et la Terrette, tributaires directs de la dépression carentanaise.
L'étude du drain centrale s'impose donc avant toute description de détail.
I. Un triple schéma.
Ce que l'on convient d'appeler le Bassin de la Vire est, en fait, l'adjonction de tranches différentes :
-1) L'une appartenant tout entière au département du Calvados, qui voit la Vire, issue du massif granitique de la forêt de Saint-Sever, se tordre entre ce massif et la barre gréseuse de la Forêt-L'Evêque. Il s'agit là d'une véritable cuvette, abondamment alimentée en eau par les hauteurs qui l'enserrent et qui greffent de multiples petits affluents à la gouttière principale, de direction Est-Ouest.
-2) La seconde, exclusivement manchoise, s'étire vers la Baie des Veys, mais avec des allures variables :
- dans un premier temps , au moins jusqu'à Condé-sur-Vire,elle se trouve corsetée entre des rives parfois imposantes, qui lui imposent une succession de méandres ;
- puis, celles-ci s'abaissent, surtout après Pont-Hébert. L'interfluve qui sépare la Vire de la Terrette passe de 120 à 30 mètres. Après quoi la Vire n'est plus bordée que de petites collines, dépassant à peine 30 mètres. Elle n'a plus de bassin propre : la dépression de Carentan loge en même temps les cours de la Douve, de la Sève et de la Taute.
Tout cela, évidemment, découle des conditions dans lesquelles s'est effectué le tracé de la rivière.
Bien que la situation soit légèrement au-delà de la limite départementale, le coude brutal de la Vire, au droit de Pont-Farcy, ne peut être ignoré.
Il y a là une rupture de direction en apparence étrange : le cours d'eau qui suivait assez fidèlement les hauteurs engendrées par le synclinal bocain(*) bifurque rapidement pour les franchir transversalement. A vrai dire, avant cette cluse, la Vire se frayait déjà un chemin dans les grès durs du Cambrien. Phénomène qui ne peut s'expliquer que par une surimposition, à partir d'une surface antérieure. Le Professeur H. ELHAI qui a, naguère, décrit la genèse de l'hydrographie de la Vire supérieure (**), suppose qu'à Pont-Farcy il y a eu capture par un autre cours d'eau, descendu des hauteurs granitiques et glissant sur une surface d'érosion prépliocène (***). Les fractures orthogonales du socle ne sont peut-être pas étrangères, non plus, à ce tracé.
Compte tenu du fort élargissement des quatre vallées qui se croisent entre Sainte-Marie-Outre-l'Eau et Pont-Farcy, on imagine plus volontiers une capture par déversement : les eaux alimentées par la dernière refonte glacière submergeant cette sorte d'ombilic et, finalement débordant les hauteurs septentrionales. La largeur du fond alluvial de Pont-Farcy le laisse à penser.
Au sortir de la cluse de Pont-Farcy, la Vire se trouve attirée par le niveau de base de la dépression carentanaise, s'enfonçant elle-même doucement sous la mer. Si elle prend une direction franchement Sud-Nord, ses affluents, par contre, conservent généralement un alignement Est-Ouest, rappelant l'orientation de la structure.
Toutefois, de Pont-Farcy à Pont-Hébert, la vallée de la Vire s'inscrit dans de vastes méandres encaissées. Leur origine ne peut se situer que dans les vibrations engendrées par les transgressions qui ont affecté le bassin de Carentan, en particulier les dernières transgressions interglacières. L'eau fluviale, refoulée par l'eau marine, sans écoulement possible, s'est rejetée de droite et de gauche, creusant ses rives pour obtenir un supplément de place.
La Vire entre progressivement dans la dépression submarine de la Baie des Veys et, sans obstacle, court en droite ligne vers le niveau de base marin . Le caractère écrasé de son profil explique les innombrables méandres divaguants, au tracé fragile.
(*) Vestiges précambriens des anciens plissements hercyniens.
(**) Thèse : " La Normandie occidentale, entre la Seine et le golfe normand-breton (1963)
(***) Le Pliocène est la dernière grande partie de l'ère tertiaire.-
III - Les caractères hydrologiques
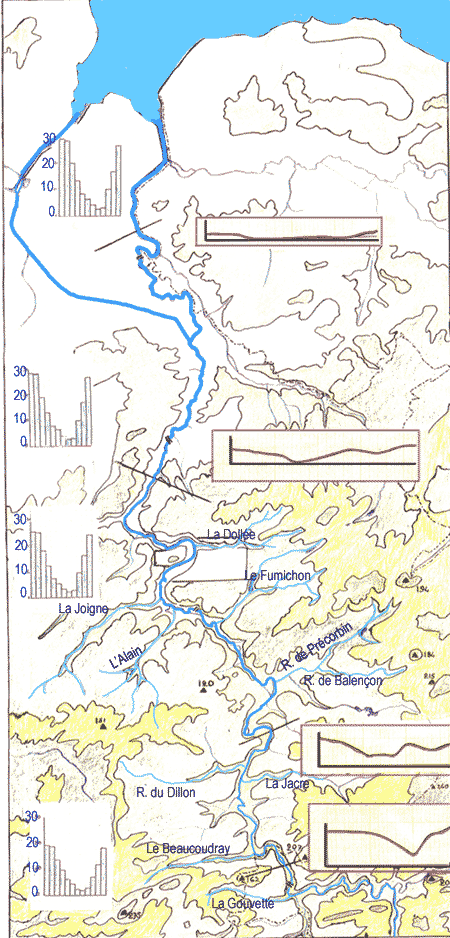 cliquez
sur la carte hydrographique pour la voir en plus grand
cliquez
sur la carte hydrographique pour la voir en plus grandQuand on compare les différents croquis du débit moyen (cf carte), on convient vite de l'identité qui les rapproche. Tous offrent un maximum de saison froide (celle-ci se prolongeant en avril) et un minimum de saison chaude (se terminant avec septembre). Rien d'étonnant puisque les précipitations, d'origine océanique, sont particulièrement le fait des trois mois d'hiver : décembre, janvier, février (cf croquis).
Les précipitations ne disparaissent pourtant pas complètement en saison chaude, mais elles se trouvent compensées par une forte évaporation (croît de l'herbe, pousse des feuilles et des cultures). Des prélèvements directs ne sont pas à exclure (*)
Le schéma ainsi défini mérite des retouches. Si l'on calcule l'amplitude entre le mois le plus fourni en eau et le plu sec, on s'aperçoit que ce rapport, qui est de 17,90m3/seconde à Pont-Farcy, passe à 23, 39, au Moulin des Rondelles, puis à 25,99 à La Meauffe, pour finir à 27,26 à Montmartin-en-Graignes. Au fur et à mesure que la rivière s'étire, la pointe de l'hiver se fait plus forte, alors que la valeur de l'étiage demeure.
Autre phénomène : l'écoulement au km2 sur l'ensemble du bassin versant, se réduit, de la partie antérieure à la partie avale. Au-dessus de Pont-Farcy, en effet, la Vire reste conditionnée par un environnement topographique assez marqué, qui accroît le ruissellement, tandis que l'alimentation se trouve pérennisée par le filtrage des eaux à travers l'encadrement gréseux ou granitoïde du bassin virois.
Après Pont-Farcy, et jusqu'à Condé-sur-Vire, la Vire reçoit encore quelques menus affluents, descendus des hauteurs voisines, moins abondants pour le bassin, mais toujours efficaces. Par contre, après Saint-Lô, le drain principal ne reçoit plus beaucoup de tributaires - à l'exception de l'Elle longue de 20,600km (**).
Au fur et à mesure que s'écartent les isohypses les plus fortes, la pente s'atténue, d'une part. Après Pont-Hébert, elle tombe en-dessous de 0,3%. D'autre part, les rives moins contenues s'évasent, laissant à la nappe díeau superficielle une largeur de 20 à 70 mètres. Ainsi, s'étale une rivière de moins en moins encaissée et de plus en plus large, donc de plus en plus sensible à l'influence maritime.
La haute vallée
depuis son affluence avec la Souleuvre jusqu'à Agneaux est inventoriée Zone
Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type II.
La richesse biologique vient des migrateurs salmonidés (truites
farios, truites de mer et saumons), Il existe 13 « gravières » protégées
le long de la Vire : ce sont les biotopes spécifiques à la reproduction et à
la croissance du saumon. A noter une population d'écrevisses à pieds blancs,
espèce autrefois courante et maintenant protégée. Les eaux
vives hébergent d'innombrables invertébrés,
éponges, vers, mollusques, crustacée, ou insectes, nouriture
d'une riche faune piscicole. La richesse piscicole
Le long du canal
de Vire et Taute
lièvre, ragondin,
campagnol, grenouille, busard des roseaux, martin-pêcheur, hirondelle de rivage,
phragmite des joncs, bruant des roseaux, rousserolle effarvatte, tarier des
prés, cigogne blanche (photo à droite), aigrette, héron cendré (photo
en bas) canard colvert, poule d'eau, fauvette,
pinson (photo)  ,
mésange,
,
mésange, 
 foulques.
foulques.
Pont-Hébert
ragondin, belette, renard, lamproie, martin-pêcheur, poule d'eau, hirondelle de cheminée, pics, mésange, chevalier giugnette (photo), bergeronette
[source des informations "les plus belles balades des marais du Cotentin et du Bessin-Parc des Marais].
La haute
vallée depuis son affluence avec la Souleuvre jusqu'à Agneaux est inventoriée
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type II.
Le long du canal de Vire et Taute
Massette (graminé)
et saules.
Pont-Hébert
aulnes, saules, peupliers.
[source des informations "les plus belles balades des marais du Cotentin et du Bessin-Parc des Marais].